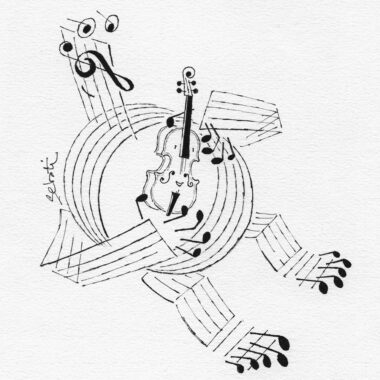Le tropisme américain de la 12ᵉ Biennale de quatuors à cordes
En l'absence des Arditti, un flux transatlantique et ses scansions répétitives traversent l'espace de la création sonore au sein de la 12ᵉ Biennale de quatuors à cordes où s'observe une forte tendance au crossover jetant des ponts entre musique dite « savante » et sources populaires.

Tanamorphose
Le Quatuor Tana fête ses quinze ans : la phalange qui s'est partiellement renouvelée depuis 2011, a demandé pour l'occasion à neuf compositeurs ou compositrices venus d'horizons différents (classique, pop, électro…) de « broder autour » du Quatuor à cordes n°1 de György Ligeti – Métamorphoses nocturnes – l'œuvre fétiche des Tana dont les huit mouvements s'entendent ce soir mais de manière intermittente : puristes s'abstenir !
Sur la scène de l'Amphithéâtre quasi comble, un rideau noir est tendu devant lequel est accrochée une structure – celle de Marc Lainé et Stephan Zimmerli – sorte de frise géante de matière blanche qui se déploie dans l'espace selon un mouvement oscillatoire et répétitif. Elle accueille durant tout le concert (1h15 non-stop) le flux d'une vidéo, celle de Baptiste Klein, alternant images abstraites aux textures évolutives et bribes de film éphémère.
Résultat d'un montage aussi virtuose que déroutant, l'œuvre est collective et performative, où les vignettes sonores (de 2' à 9') alternent avec les mouvements du quatuor à cordes de Ligeti, neutralisant le flux dramaturgique nourri de contrastes prévu par le compositeur hongrois.
Des accessoires – le métronome (meccanico) et une boite à musique (grazioso) pour les miniatures de Paul Haring –, la bande son de Christian Zanési (synthétiseur Moog Minitaur) dans Ombres portées, la voix off dans Linga Franca de la britannique Anne Dudley ou les sifflements des musiciens dans Continuous Partial Attention de Graham Fitkin, le son de la guitare électrique de David Torn dans Rezoneaza ou encore l'écriture minimaliste d'un Philip Glass dans Quantum Paradox de Delphine Malausséna qui boucle la trajectoire, sont autant de rebonds sonores à la musique de Ligeti et de couleurs qui prolifèrent, et si le cheminement est un rien labyrinthique, la performance des Tana est toujours au cordeau, portant ici le concept de métamorphose dans l'espace de tous les possibles.
Quatuor Isidore : A minima

On retrouve György Ligeti et son Quatuor à cordes n°2, le lendemain avec le Quatuor Isidore, jeune phalange new-yorkaise fondée en 2019 qui fait ses débuts sur la scène française. Le quatuor est composé en 1968, soit dix ans après le premier, alors que le compositeur a quitté la Hongrie pour s'installer à Vienne. L'œuvre relève de l'écriture micropolyphonique des années 60 dont Ligeti tente de réduire le nombre des voix à quatre, menant un travail tout aussi minutieux sur la texture, le timbre et les oppositions de registres qu'il aime pratiquer. Les indications de caractère sont nombreuses et précieuses – Allegro nervoso (1), sostenuto, molto calmo (2), Come un mecccanismo di precisione (3), etc. Si les contrastes sont un peu outrés sous les archets des Isidore, la couleur trop neutralisée dans le 2 et l'aspect ludique et jubilatoire un rien masqué dans le 3, ils sont davantage convaincants dans les deux derniers mouvements conçus dans la transparence et la fragilité d'une matière qui se volatilise in fine.
Conceptuelle et radicale, la pièce suivante ne fait pas l'unanimité si l'on en juge par la réception du public. Jouée dans un temps long et au seuil de l'audible, Everything Changes, Nothing Changes de l'États-unien Tyshawn Sorey repose sur la permutation de 16 unités rythmiques qui modifient les configurations sonores à chaque coup d'archet et invite l'auditeur à une expérience d'écoute liminale, comme celle de Morton Feldman dans son Quatuor II d'une durée de 5 heures. Fort heureusement, la pièce de Sorey ne dure que 25 minutes, dûment défendue par les Isidore toujours a minima.
Jouer Beethoven est une autre expérience pour laquelle le jeune Quatuor semble moins préparé. Á l'affiche, le Quatuor à cordes n°6, dernier du premier opus (18) consacré à un genre que Beethoven ne va cesser d'illustrer. D'emblée le son un rien acide, les problèmes d'intonation et le maniérisme du jeu, à la recherche d'effets plus qu'au service de la musique, nous irritent, dans L'Allegro con brio autant que dans l'Adagio ma non troppo. Le Scherzo met en valeur les qualités de leader du premier violon mais le final – la Malinconia – déçoit, manquant de profondeur dans le son et de tension dramaturgique.
Brooklyn Rider : vers l'éclectisme

Ils sont américains, ils jouent debout et s'adressent au public ; ils ont mis à leur programme, intitulé Citizenship Notes, sept compositeurs ou compositrices américain(e)s, sept pièces courtes et récentes pour la plupart, qui explorent les thèmes de la citoyenneté et de la démocratie dans le paysage socio-politique de leur pays. Leur nom, Brooklyn Rider, évoque celui du groupe d'artistes munichois Der blaue Reiter et leurs choix, le long compagnonnage avec Philip Glass aidant, affirment un penchant certain pour les musiques répétitives et l'énergie de la pulsation.
Schisma (2018) de Caroline Shaw, écrit en réponse à la crise des réfugiés syriens, est une courte pièce aux différents éclairages, entre Bartók (côté percussif) et Glass (répétition), entretenant la pulsation sur laquelle naissent différentes propositions. Énergétique, voire obsessionnel, We Are Working Tirelessly For a Ceasefire (2025) de Ted Hearne met à l'œuvre la synergie des quatre archets et une mécanique bien huilée dans une pièce qui ménage de forts contrastes, ramenant le temps lisse pour terminer. La pulsation est entretenue, le discours est sous tension et les quatre instruments solidaires dans le Quatuor à cordes n°3 (2025) de Don Byron où s'entendent les scansions d'un violon très stravinskien. Le jeu des Brooklyn Rider est sans vibrato et le son volontiers acidulé. Our Children Speak Spanish and English (2025) d'Angélica Negrón, dédiée aux enfants portoricains, est une pièce mixte, confrontant de manière sensible les voix enregistrées d'enfants s'exprimant en espagnol à l'écriture intermittente et plus musclée du quatuor qui semble s'attendrir à leur écoute.
La nostalgie des années 60
Borderlands… (abordant la crise frontalière entre le Mexique et les Etats-Unis) de Matana Roberts est une pièce « intuitive » comme celles de Stockhausen dans les années 60 (Aus den sieben Tagen), proposant aux interprètes une partition graphique qu'ils « interprètent » en live. Les gestes sont anticipés autant que la trajectoire même si les musiciens jettent à tour de rôle des dés qui semblent décider de l'orientation sonore. Nostalgique également, cet arrangement de la chanson The Time They Are a-Changin' de Bob Dylan par le violoniste Colin Jacobsen, dont il chante le thème, épaulé par son partenaire violoncelliste Michael Nicolas, avant de reprendre son violon pour les variations.
La couleur des cordes change dans la chanson American Studies (2023) de Gabriel Kahane en mode « country ». Le violoncelliste tape du pied et les violons déploient leur mélodie avant une série de digressions libres qui laissent apprécier, au sein du quatuor, la qualité d'un jeu rompu à toutes les techniques étendues sur les cordes et la virtuosité débridée de nos quatre interprètes remportant un franc succès auprès d'un public sous le charme.
Un final très beethovénien
Le Quatuor Ébène a débuté la Biennale et la referme, dans l'espace de la Grande salle Pierre Boulez un rien démesurée au vu de la phalange qui a mis sur son pupitre le Quatuor op.59 n°2 « Razoumovsky » de Beethoven. Un sacré challenge pour les quatre musiciens qui prennent possession de l'acoustique des lieux dans un premier mouvement bien conduit où l'équilibre et la synergie du geste sont souverains. Ils concentrent toute l'attention dans le superbe mouvement lent (molto adagio) qui fait apprécier le grain de son des Ébène et l'épaisseur dramatique que les musiciens lui confèrent. La sonorité se déploie dans le Scherzo où Beethoven cite, en son centre, le thème russe proposé par le comte Razoumovski (dédicataire de l'œuvre) entendu sous chacun des archets dans l'élan d'un fugato. La finesse et la brillance du premier violon mis en vedette (Pierre Colombet) opère dans un final très enlevé où la cohérence du jeu, l'équilibre des pupitres et le contrôle du son font merveille.

À la cheffe Kristiina Poska est lancé un autre défi, celui de conduire la masse des cordes de l'Orchestre Français des Jeunes au sein du labyrinthe contrapuntique de la Grande fugue en sib majeur op.133, prévue initialement par Beethoven pour clore son quatuor op.130. L'arrangement pour orchestre à cordes est réalisé par Félix Weingartner, « une aberration » selon le musicologue Bernard Fournier qui y déplore l'affaiblissement des effets sonores et expressifs demandés aux interprètes du quatuor. Mais la cheffe veille au grain, gère l'équilibre au sein des plans sonores et ménage de beaux contrastes – la puissance du thème générateur « herculéen nous saisit – emmenant son orchestre dans les méandres de l'écriture beethovenienne sans rien lâcher et en relevant vaillamment le défi.

Les Ébène reviennent, entourés cette fois par l'Orchestre Français des Jeunes au complet, incluant célesta, piano et set de percussions. La formation pour quatuor à cordes et orchestre est rare ; citons le Quatuor VI, Hinterland, hapax de Pascal Dusapin, créé dans cette même Biennale il y a quelques années de cela. Elle a tenté l'Américain John Adams qui écrit en 2011-2012 Absolute Jest (littéralement « Plaisanterie absolue), « un exerce de l'esprit qui passe par l'imagination et l'invention », écrit-il dans sa note d'intention. Amusant, certes, mais vite lassant. À l'exemple de Pulcinella de Stravinsky, « recyclant » un matériau préexistant, Adams se tourne vers la musique de Beethoven (thèmes de quatuors et de symphonies), travaillant sur des échantillons prélevés et modelés à sa guise : ainsi entend-on les timbales en verve (Symphonie n°9), des échos de la « Pastorale » fusant aux bois et les thèmes célèbres de quatuors qui patinent aux cordes, rappelant le goût avéré du maître de Bonn pour la répétition. L'écriture est dense voire confuse, l'ensemble composite, bruyant et sans grande finesse. Pour autant, Adams soigne son final, entraînant le tutti dans un flux pulsé et bouillonnant au gré de l'énergie sans faille déployée par la cheffe et ses musiciens, processus dans sa pleine efficacité qui déclenche l'ovation d'un public conquis.
Crédit photographique : © Philharmonie de Paris / ResMusica
Lire aussi :
Un après-midi pour les jeunes quatuors à la Biennale de la Philharmonie de Paris