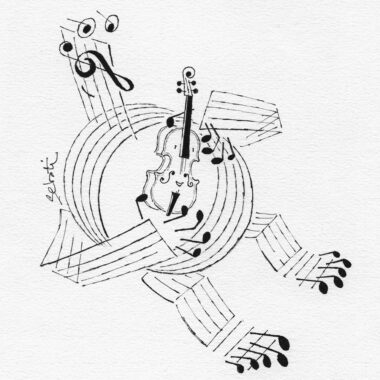Prise scénique de Werther pour Pene Pati à l’Opéra Comique
Avec une nouvelle production de Werther à l'Opéra Comique, Paris découvre le ténor Pene Pati dans le rôle-titre, seulement quelques mois après Benjamin Bernheim au Théâtre des Champs-Élysées. Le reste laisse plus circonspect.
 Même si les grands opéras romantiques attirent avant tout pour les interprètes de leurs rôles principaux, la nouvelle production du drame lyrique le plus célèbre de Massenet à l'Opéra Comique créait aussi certaines attentes envers la mise en scène de Ted Huffman et l'approche interprétative de Raphaël Pichon.
Même si les grands opéras romantiques attirent avant tout pour les interprètes de leurs rôles principaux, la nouvelle production du drame lyrique le plus célèbre de Massenet à l'Opéra Comique créait aussi certaines attentes envers la mise en scène de Ted Huffman et l'approche interprétative de Raphaël Pichon.
Dans les deux cas, le résultat ne marquera pas les esprits, avec plus de réussite tout de même pour le premier que pour le second. En coproduction avec Rennes – où l'on avait déjà pu revoir sa très intéressante production du Couronnement de Poppée de Monteverdi, créée à Aix-en-Provence en 2022 – la proposition d'Huffman pour l'opéra français d'après Goethe s'intègre plus dans la continuité minimaliste de celle récente d'Otello de Verdi à Strasbourg. Il faut dire que depuis quelques années, l'artiste est devenu un metteur en scène courtisé, et même récemment un directeur de grand festival, entrant par la même occasion dans ce cercle à simplifier les idées, par manque de temps et accumulation des projets.
Alors, le travailleur ingénieux ne prend pas de risque : la scène est réduite au fondamental, un décor blanc volontairement peu assimilable à une période ou un lieu précis. Encore plus qu'avec Christof Loy avec Benjamin Bernheim en mars dernier au TCE, le drame se veut intemporel et universel. Deux êtres s'aiment mais ne prennent pas la décision de le montrer, alors ils souffrent… à en mourir. Et c'est la vraie réussite de cette production : en reprenant un couple principal à fleur de peau en version de concert à Genève puis Strasbourg moins d'un an plus tôt, l'opéra devient avec ces prises de rôles scéniques une pièce de théâtre intimiste. Meilleure illustration de cette approche, la scène finale sur un plateau dénudé à faire « pleurer les pierres », dans cette salle qui a lancé pour de bon la carrière de Werther en 1903, un an après la création de Pelléas au même endroit.
Beaucoup moins passionnante bien que défendable, la direction de Raphaël Pichon devant son Ensemble Pygmalion consiste en une mode de jouer « sur instruments d'époque » des ouvrages romantiques qui ne demandent que la flamme et les effusions des instruments modernes, qui étaient déjà en train d'apparaître au moment où les partitions étaient composées. On pourra donc comprendre la manière de décortiquer et d'analyser la partition, mais au prix d'un ennui réel dans les premiers actes, et d'une attention sur les répétitions de courts thèmes cycliques plutôt qu'un émoi face au drame en train de se jouer. Il est aussi possible de justifier ce dépouillement par le fait qu'il accroit le réalisme du livret recherché par la mise en scène, mais cela le place très loin des couleurs et de l'extase lyrique d'un Plasson avec Kaufmann il y a 15 ans à Bastille, sans que l'approche héroïque beethovénienne des introductions aux actes I et III ne possède la densité qu'y mettait d'autres chefs en lorgnant plus du côté de Wagner, dans des visions post-romantiques bien plus impactantes que celle dénuée d'agitation de Pichon.
 Alors, il reste à se tourner vers la distribution, où là encore transparaît le réalisme au détriment du romantisme, qui donne à entendre une Sophie moins claire que pour d'autres productions en la personne de Julie Roset. Et finalement, celle-ci est bien adaptée à la proposition en ne jouant pas au rossignol en début d'acte III, bien qu'elle puisse briller dans les trilles et les aigus de cette scène. Le bailli de Christian Immler cherche aussi surtout à bien énoncer le livret, parfait dans la diction tout comme John Chest, irréprochable pour Albert dans son traitement très théâtral du rôle. Dans ce contexte, les Johann de Jean-Christophe Lanièce et Schmidt de Carl Ghazarossian ressortent peu, mais au moins ne donnent-ils pas un effet de contre-emploi comme celui créé par les chants de Nöel des enfants de la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique, qui semblent préparés pour un Stabat Mater par le chef.
Alors, il reste à se tourner vers la distribution, où là encore transparaît le réalisme au détriment du romantisme, qui donne à entendre une Sophie moins claire que pour d'autres productions en la personne de Julie Roset. Et finalement, celle-ci est bien adaptée à la proposition en ne jouant pas au rossignol en début d'acte III, bien qu'elle puisse briller dans les trilles et les aigus de cette scène. Le bailli de Christian Immler cherche aussi surtout à bien énoncer le livret, parfait dans la diction tout comme John Chest, irréprochable pour Albert dans son traitement très théâtral du rôle. Dans ce contexte, les Johann de Jean-Christophe Lanièce et Schmidt de Carl Ghazarossian ressortent peu, mais au moins ne donnent-ils pas un effet de contre-emploi comme celui créé par les chants de Nöel des enfants de la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique, qui semblent préparés pour un Stabat Mater par le chef.
Finissons par le meilleur avec une Adèle Charvet qui certes ne renouvelle pas le rôle, mais lui donne une modernité et une sensualité toutes particulières, sans rechercher le côté grand-opéra de son air principal, livré dans la continuité de ses troubles émotionnels apparus aux actes précédents. D'une extrême délicatesse, Pene Pati ne pousse jamais son appareil pour concurrencer les plus grands dans ce rôle-titre qui les a tous vu passer depuis un siècle. Au contraire, il profite comme par désespoir de son timbre solaire, sans oublier tout de même de projeter ses aigus incandescents dans les grands moments. Son air le plus célèbre n'est comme celui de Charlotte pas particulièrement mis en valeur, le metteur en scène lui demandant de le chanter tête baissée en faisant semblant de lire un livre, pour éviter de créer une rupture dans le rationalisme de la proposition, en même temps que rapprocher le livret français du roman épistolaire allemand. À terre dans une mare de sang, il reflète avec la même sensibilité le calme éternel recherché dans les derniers instants, très touchants.