Un Siegfried sans éclat à l’Opéra Bastille
Sur la scène de l'Opéra Bastille, Calixto Bieito poursuit son cycle wagnérien avec ce troisième volet de la Tétralogie de l'Anneau du Nibelung… Si L'Or du Rhin nous avait laissés perplexes et dubitatifs, et si la Walkyrie n'avait pas levé les doutes quant au bien-fondé de la vision futuriste du metteur en scène catalan, Siegfried n'est pas là aujourd'hui pour nous rassurer…
 Si l'histoire se poursuit avec un retour salutaire à plus de cohérence et de fidélité au livret, Calixto Bieito peine une fois encore à convaincre, échouant à rassembler tous les éléments épars de cette mise en scène qui oscille, avec quelques digressions entre le merveilleux (la forêt animée illuminée) et le trivial (Mime qui se drogue dans un coin, une portière de voiture abandonnée dans la forêt, un seau en ferraille en guise de forge…) L'Or du Rhin avait mis en scène les méfaits de la high-tech sur notre liberté, la Walkyrie s'était poursuivie dans un cosmos militarisé qui avait vu le monde numérique s'effondrer pour laisser place à une Apocalypse où l'amour avait fleuri au milieu des décombres. C'est au sein de ce monde toxique et contaminé, dans une forêt « mutée » que nous retrouvons aujourd'hui Siegfried, héros de conte (les frères Grimm ne sont pas loin) qui devra au terme d'un voyage initiatique, dans une épopée héroïque, tuer un dragon, conquérir un précieux trésor et délivrer une vierge endormie avec laquelle il retrouvera l'Amour rédempteur et le désir charnel, signant l'âge de l'Homme, celui du héros libre en même temps que l'agonie des dieux. Dans sa Tétralogie Wagner avait commencé sa saga par Siegfried, dont la composition fut interrompue en son mitan, entre l'acte II et l'acte III, par l'écriture de Tristan ; ceci expliquant tout particulièrement les analogies entre les duos d'amour de l'acte II de Tristan et de l'acte final de Siegfried, merveilleux duo chargé d'émotion et de passion qui sauve à lui seul cette nouvelle production.
Si l'histoire se poursuit avec un retour salutaire à plus de cohérence et de fidélité au livret, Calixto Bieito peine une fois encore à convaincre, échouant à rassembler tous les éléments épars de cette mise en scène qui oscille, avec quelques digressions entre le merveilleux (la forêt animée illuminée) et le trivial (Mime qui se drogue dans un coin, une portière de voiture abandonnée dans la forêt, un seau en ferraille en guise de forge…) L'Or du Rhin avait mis en scène les méfaits de la high-tech sur notre liberté, la Walkyrie s'était poursuivie dans un cosmos militarisé qui avait vu le monde numérique s'effondrer pour laisser place à une Apocalypse où l'amour avait fleuri au milieu des décombres. C'est au sein de ce monde toxique et contaminé, dans une forêt « mutée » que nous retrouvons aujourd'hui Siegfried, héros de conte (les frères Grimm ne sont pas loin) qui devra au terme d'un voyage initiatique, dans une épopée héroïque, tuer un dragon, conquérir un précieux trésor et délivrer une vierge endormie avec laquelle il retrouvera l'Amour rédempteur et le désir charnel, signant l'âge de l'Homme, celui du héros libre en même temps que l'agonie des dieux. Dans sa Tétralogie Wagner avait commencé sa saga par Siegfried, dont la composition fut interrompue en son mitan, entre l'acte II et l'acte III, par l'écriture de Tristan ; ceci expliquant tout particulièrement les analogies entre les duos d'amour de l'acte II de Tristan et de l'acte final de Siegfried, merveilleux duo chargé d'émotion et de passion qui sauve à lui seul cette nouvelle production.

La scénographie de Rebecca Ringst repose durant les deux premiers actes sur la représentation d'une forêt magique, décodée et reprogrammée, mutée, où les arbres se déplacent verticalement et transversalement, la cime vers le bas au mépris de toute gravité, parcourue encore par quelques créatures humanoïdes, seules survivantes de la catastrophe écologique. Dans cette dystopie sombre, obscure, qui n'est pas sans rappeler l'opéra romantique allemand (on pense au Freischütz de Weber), Siegfried vit toutes ses aventures en communion avec la Nature, guidé par le chant de l'Oiseau, avant de retrouver Brünnhilde enfermée dans une salle de congélation, derrière une lucarne fermée par un épais voile de plastique transparent du plus vilain effet. Les costumes contemporains de cette proposition scénique sont hideux, les éclairages entretiennent la pénombre pénalisant la visibilité de la scène, la direction d'acteur est banale et répétitive (Siegfried passe son temps à jeter tout ce qui lui passe par la main), seule la vidéo très réussie de Sandra Dereninger, projetée sur les arbres de la forêt permet d'en renforcer le côté magique et poétique. Face à la complexité du livret (concept, symboles…), l'échec relatif de cette lecture de Calixto Bieito est bien celui de la représentation qui, sans force ni message clair, et faute d'en limiter un périmètre précis, échoue à restituer toute la magie et la poésie du propos, se condamnant à une narration terne d'une immanence parfois grotesque.

La distribution vocale, homogène et de haut niveau, est probablement l'élément le plus attrayant de cette nouvelle production, dominée par l'incontournable Siegfried d'Andreas Schager dont on admire la vaillance et l'endurance vocales, malgré quelques défaillances transitoires, dans le rôle du jeune, fort et intrépide héros qui n'a jamais connu la peur. Nombre de chanteurs étaient déjà présents lors des épisodes précédents : Gerhard Siegel, intrigant, cupide et manipulateur à souhait campe un Mime plus vrai que nature, à l'instar de l'Alberich vindicatif de Brian Mulligan ; par sa projection limitée, Marie-Nicole Lemieux ne nous convainc toujours pas en Erda malgré des graves profonds et bien timbrés ; Tamara Wilson est une Brünnhilde de luxe par sa puissance vocale, son timbre rayonnant, comme par son engagement scénique impressionnant dans le duo final ; Derek Welton est un Wanderer (Wotan) plein de hargne à la ligne de chant généreuse ; Mika Kares prête malheureusement sa basse grave et profonde à un dragon de pacotille aux allures de manège pour enfants ; enfin Llana Lobl-Torres, en joli canari, incarne un Oiseau de la Forêt plein de fraicheur.
Dans la fosse, la direction de Pablo Heras-Casado est finalement à l'image de cette production suivant une courbe ascendante en alternant le bon et le moins bon : plutôt réservé dans l'acte I pour atteindre toute sa superbe dans l'acte III et le duo d'amour final, nous laissant finalement sur une bonne impression.





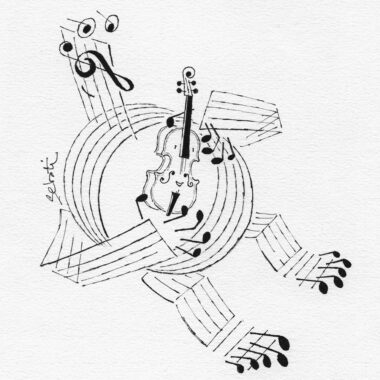


En ce qui me concerne, je ne peux que souscrire au commentaire précédent. Heureusement que des chanteurs comme l’excellent Andreas Schager ou Gerhard Siegel sauvent la soirée.
Ajoutons que lorsque Wagner disait « Faites du nouveau » il ne pensait nullement aux mises en scène, comme cela a été prétendu. Sa remarque était purement d’ordre musical et visait des compositeurs (Berlioz notamment) accusés de recycler leurs oeuvres antérieures.
Pour commencer j’inviterais volontiers chacun à écouter la merveilleuse page musicale « Les Murmures de la forêt » extraite du Siegfried de Richard Wagner – et à se demander si ladite page leur inspire une image aussi hideuse que celle qui figure en illustration de la critique, ici, celle avec la créature à lunettes, jaune.
En réalité, nous avons ici, une fois encore, une véritable escroquerie qui consiste à vendre du « spectacle » aussi laid qu’ennuyeux, pour une oeuvre de Richard Wagner.
Et s’il vous plaît, ne venez pas parler ici d' »art vivant » ! Nous n’avons nul besoin de M. Bieito pour rendre Siegfried vivant en nous qui aimons les oeuvres de Richard Wagner ! Et nous aimerions voir sur scène un peu plus de poésie, de respect de la musique, du poème, de l’esthétique voulue par le compositeur… Et nous aimerions aussi que les metteurs en scène laissent libres chacun de comprendre les oeuvres comme ils les entendent. Ce qui était le cas, de manière à peu près générale, jusque dans les années 1970, bien qu’avec une grande diversité. A l’époque, on connaissait encore le sens du mot « nuances ». Chaque metteur offrait sa vision des oeuvres qu’il portait sur scène, mais avec nuances, sans souligner au marker violet les choses, sans basculer dans la caricature, la transposition, l’actualisation à toute force ! Bref, on connaissait encore, à l’époque, le sens du mort « art ».