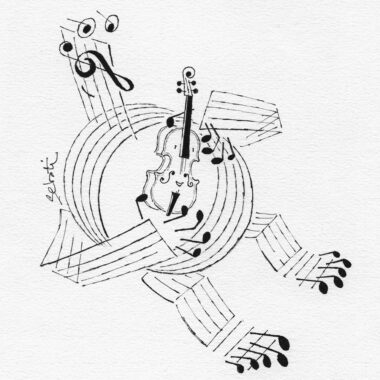Tristan et Isolde par Thorleifur Örn Arnarsson : suicide mode d’emploi
Après Lohengrin à Augsbourg en 2014, Siegfried à Karlsruhe en 2018, Parsifal à Hanovre en 2023, et avant Tannhaüser à Zürich en 2026, c'est à Bayreuth en 2024 que le metteur en scène islandais a apposé son style venu du froid sur le plus brûlant des opéras de Wagner.
Tout a certainement été dit sur le génie du Tristan et Isolde de Richard Wagner. Sur cet extraordinaire contraste né de l'immobilité dépouillée d'une action sans action (bien que l'opéra soit sous titré -avec humour?- “action en trois actes”) et de la volubilité torrentueuse d'un orchestre en technicolor. Quatre heures de musique d'une jeunesse inaltérable pour la plus vieille histoire du monde: deux personnages pris dans la nasse des sentiments. Même le chœur est prié de s'en tenir au hors-champ. Tout ça parce qu'un être humain a regardé un autre être humain “dans les yeux”.
Si l'on avait émis quelques réserves sur le Siegfried vu par Thorleifur Örn Arnarsson, la manière du metteur en scène islandais convient plutôt bien à “l'oratorio lyrique » de Wagner dont les seules embardées scénaristiques sont reléguées aux fins d'actes, toutes particulièrement impressionnantes (même dans cette nouvelle mise en scène) dans leur façon de traduire musicalement les moments où le monde extérieur fait irruption dans le monde intérieur des amants qui, le dit-on, n'aiment rien tant qu'être seuls au Monde. Même si c'est pour le quitter. Chez Arnarsson personne ne mourra. Hormis elle et lui, qui ne pensent qu'à « ça ».
L'immense chef-d'œuvre importe au Festspielhaus le style Arnarsson. Un style immédiatement identifiable, ce qui n'est pas donné à tous. A l'instar de son Siegfried se déroulant essentiellement dans une sorte de brocante du vécu du héros, les amants de son Tristan attirés, à la fin d'un Acte I se déroulant sur un pont de navire éventré, par la béance discernable en son centre, atterriront au II dans la cale encombrée (comme les pré-requis du livret) de souvenirs. Ceux d'Isolde notamment dont le passé chargé (une mère magicienne, un ex-amant-soldat…) ont progressivement généré un invraisemblable bric-à-brac, la dame ne sachant visiblement pas jeter, obstinée de surcroît à griffer l'étouffante corolle de sa robe de mots arrachés au synopsis de l'opéra (Mir erkoren et autres Betrug…), auto-empêtrée, comme son partenaire calligraphié à même la peau, dans le poids d'un passé qui n'est pas passé et qui ne passera pas. Si l'Acte II est la brocante des souvenirs, le III en sera la décharge.
Rien qui contrecarre le sens de l'œuvre, son interminable éloge de la mort culminant dans un Lass mich sterben chanté comme Ich liebe dich, même si Arnasson procède à une utilisation inédite du philtre et dépeint les fidèles comparses Brangäne et Kurwenal en omniscients pétrifiés par le double suicide à venir. L'épure relative (entre autres, de très beaux effets de lumière rasant la brume marine d'un Acte I réduit à quelques cordages) de cette nouvelle production trop vite venue remplacer le choc esthétique de celle de Roland Schwab (prévue dans l'urgence de la pandémie de 2020) laisse une place conséquente à l'imaginaire de son spectateur.
Comme à l'art de ses chanteurs. Bayreuth a une fois encore réuni, comprimarii compris, du Marin gracieux de Matthew Newlin au Melot viril de Birger Radde, une équipe vocale de premier ordre. Les moyens de Camilla Nylund sont aujourd'hui ceux d'une Isolde. Bien projeté dans le courroux comme dans le dégel, son soprano affronte sans faillir le ressac des passions. Contrairement à elle, son partenaire n'est pas un novice, qui a déjà fait ses classes chez Tcherniakov. Ceux qui se disent lassés par un Andreas Schager chantant uniment fff en seront pour leur frais avec son Tristan des plus nuancés qui soient, bouleversant de bout en bout (on sait le chanteur très bon acteur, même dans le minimalisme), et dont on se prend même à convoiter la très chic garde-robe. Gravitant autour de ce Tristan aimé de tous (comme le dit la légende, comme l'avait bien montré Sellars, et comme l'effleure Arnarsson), Olafur Sigurdarson et Günther Groissboöck s'imposent, le premier avec un Kurwenal en bloc d'émotion contenue, le second avec un Marke au visage dévasté par le chagrin. D'une forme qu'on ne lui a pas toujours connue, Christa Mayer n'est pas loin de ressusciter le souvenir impérial, dans le même rôle, de Christa Ludwig, notamment au moment des appels de l'Acte II, absolument grandioses dans le Temple de la Colline verte.
Dirigé avec intensité, élan, et toute la volupté nécessaire (le début du II) par un Semyon Bychkov accordé au funèbre du spectacle, l'Orchestre du Festival est à la hauteur de sa réputation, cuivres, bois et timbales, parfaitement dosés, parfaitement intégrés dans la gigantesque symphonie pour cordes de Wagner.
Prodigue en intériorité, même si bien évidemment à des années-lumières en terme de spectacle pur du Tristan et Isolde d'Olivier Py, le seul à ce jour à avoir mis cet opéra immobile en mouvement, celui de Thorleifur Örn Arnarsson, plutôt bien capté par Michael Beyer qui ne commet que l'erreur de ne pas priser les plans d'ensemble aux moments où la scénographie s'anime, est loin de mériter les huées qui concluent ce DVD.